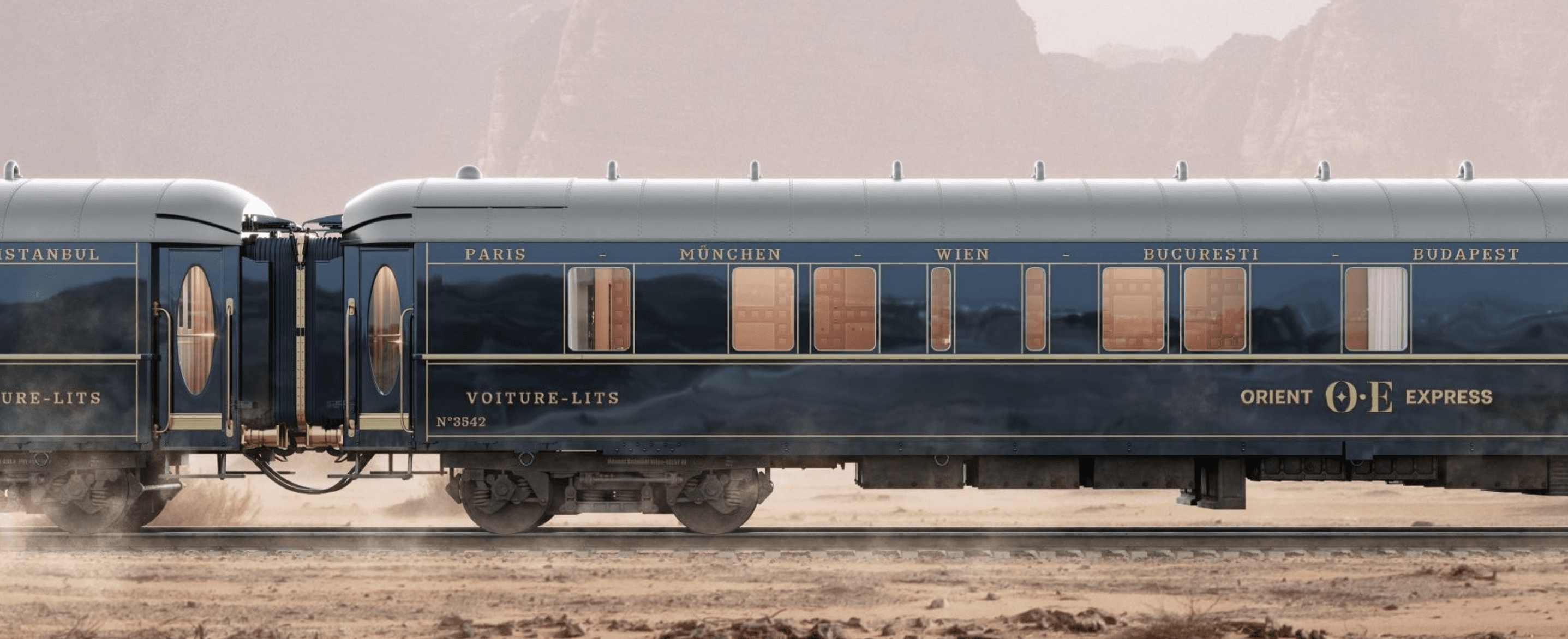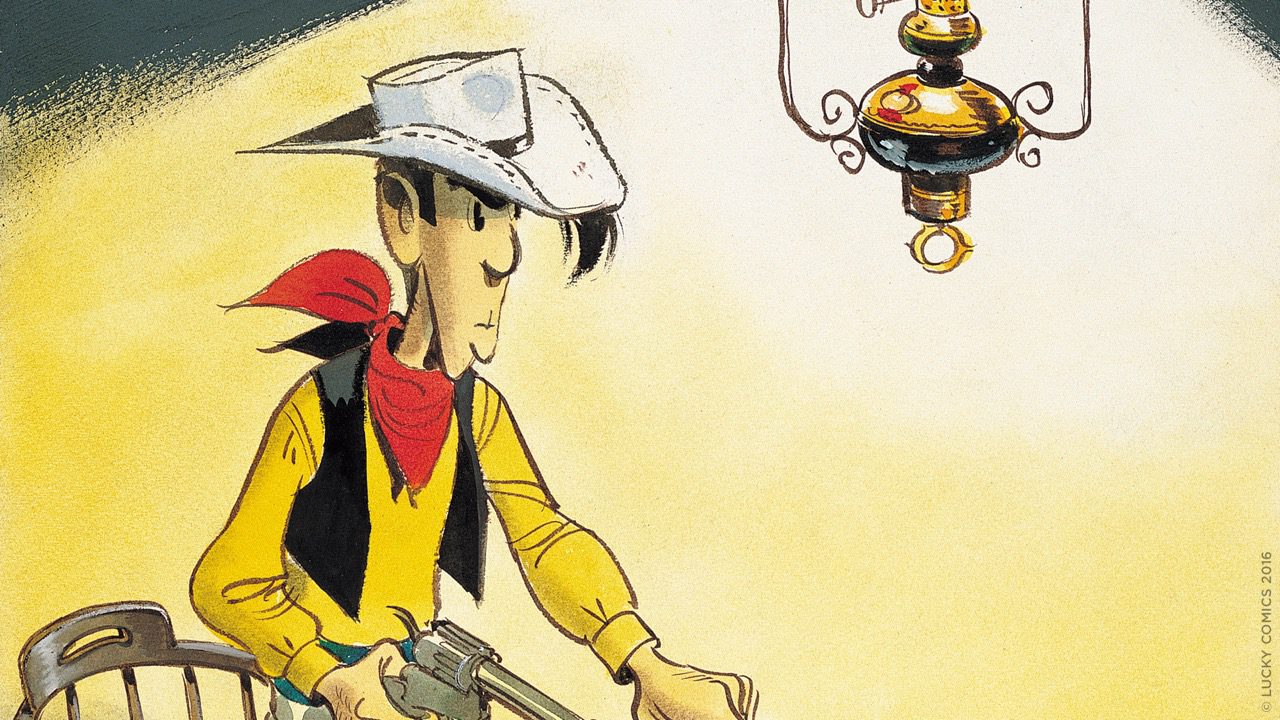Chaque année, les dictionnaires intègrent de nouveaux mots et en délaissent d’autres. Mercredi 15 juin, un mois environ après la publication de l’édition de l’année 2023 du Petit Robert, est sortie la version papier du Petit Larousse illustré et, avec lui, les fameuses nouvelles entrées. Celles-ci sont au nombre de 150. L’occasion d’observer l’évolution de notre société à travers la langue que nous parlons.
Les nouveaux mots de cette édition 2023
Parmi les nouveautés, on retrouve des termes récents qui ont fait l’actualité de ces deux dernières années. Nombre d’entre eux sont liés à la pandémie de Covid-19 avec “vaccinodrome”, “covid long”, “pass sanitaire” et “pass vaccinal” ou encore “enfermiste”. Le domaine de la gastronomie est également étoffé avec le “poke”, ce plat hawaïen qui a su trouver son public en peu de temps. On s’étonne que le merveilleux “dhal”, pourtant indispensable à toute alimentation digne de ce nom, fasse seulement son apparition. On salue l’entrée de “polliniser” et on se réjouit d’apprendre un nouveau nom d’oiseau. Ainsi, on découvre que le “kakapo” est un perroquet nocturne présent en Nouvelle-Zélande.

Crédits : Lydia Uddstrom
La société nous apporte à son tour son lot d’expressions nouvelles telles que “grossophobie”, “cyberharcèlement”, “pervers narcissique” et autres joyeusetés. L’ ”effet Matilda” — qui consiste à minimiser systématiquement la contribution des femmes à la recherche scientifique — fait également son entrée, ainsi que le fameux “wokisme”.
L’édition 2023 est l’occasion de se souvenir qu’il y a huit ans, c’était le terme “vegan” qui entrait dans le Larousse. Au vu de la place que le véganisme a prise dans la société depuis lors, on ne peut que constater la nécessité du fait de nommer.
Autrice : la consécration d’un mot hautement symbolique
Si le Petit Robert intègre le pronom “iel” à son édition papier, le Larousse, traditionnellement plus conservateur, pour le moment, regarde ailleurs. En revanche, le dictionnaire nous fait le plaisir de confirmer un mot à haute valeur symbolique, le tapageur “ophrys”. Exit le discret “e” muet placé timidement après le masculin “auteur” et qui disait bien tout ce qu’il représentait. Bienvenue à la tonitruance du ‑trice, qui ne s’excuse pas d’être là. Rejeté en 2019 par l’Académie française, le terme polémique qui date pourtant du Ier siècle (avec sa première forme autrix) n’est donc plus, d’une quelconque façon qui soit, une faute de français, ni encore moins une hérésie. Quelle embellie !